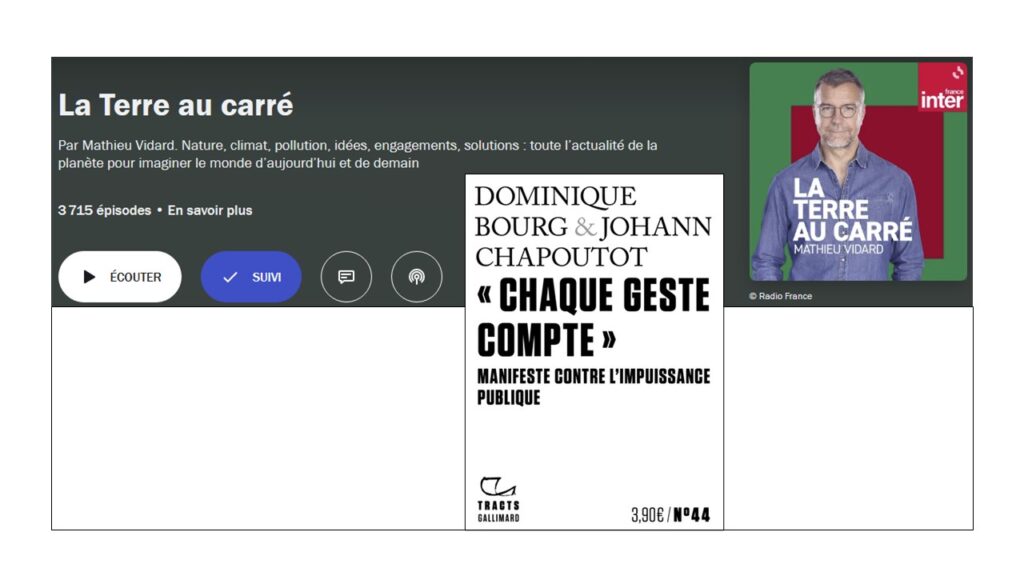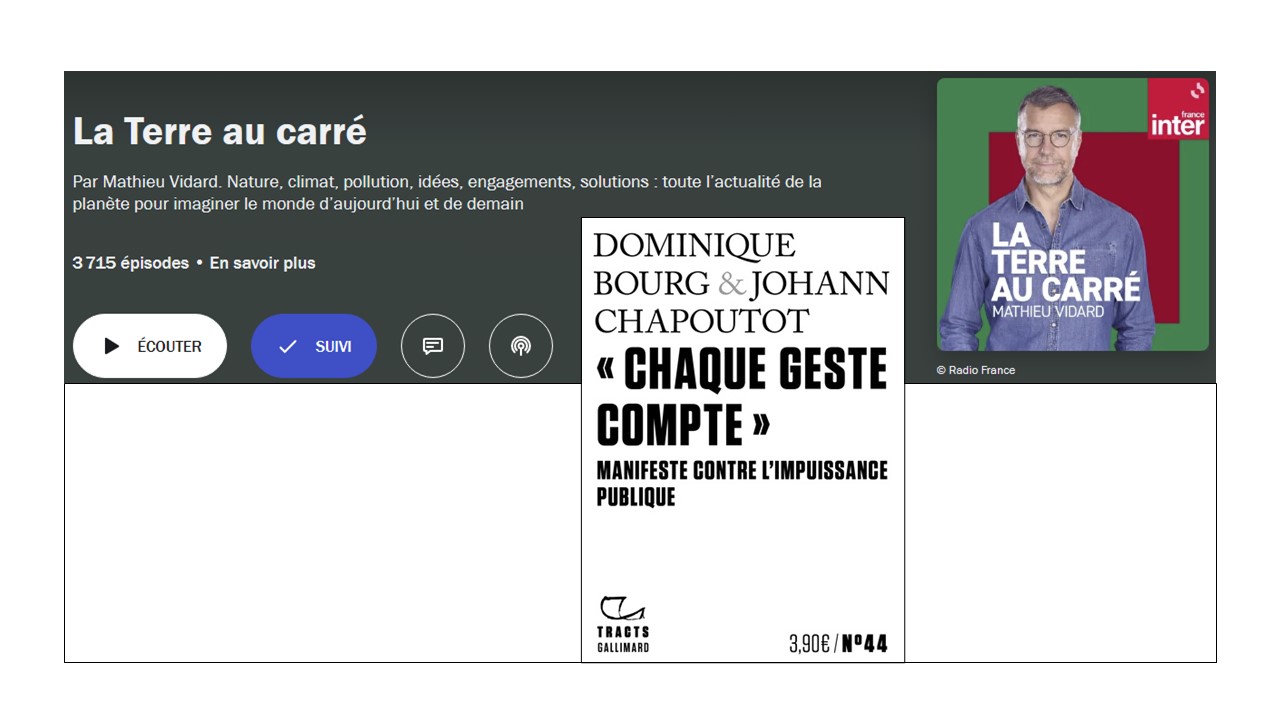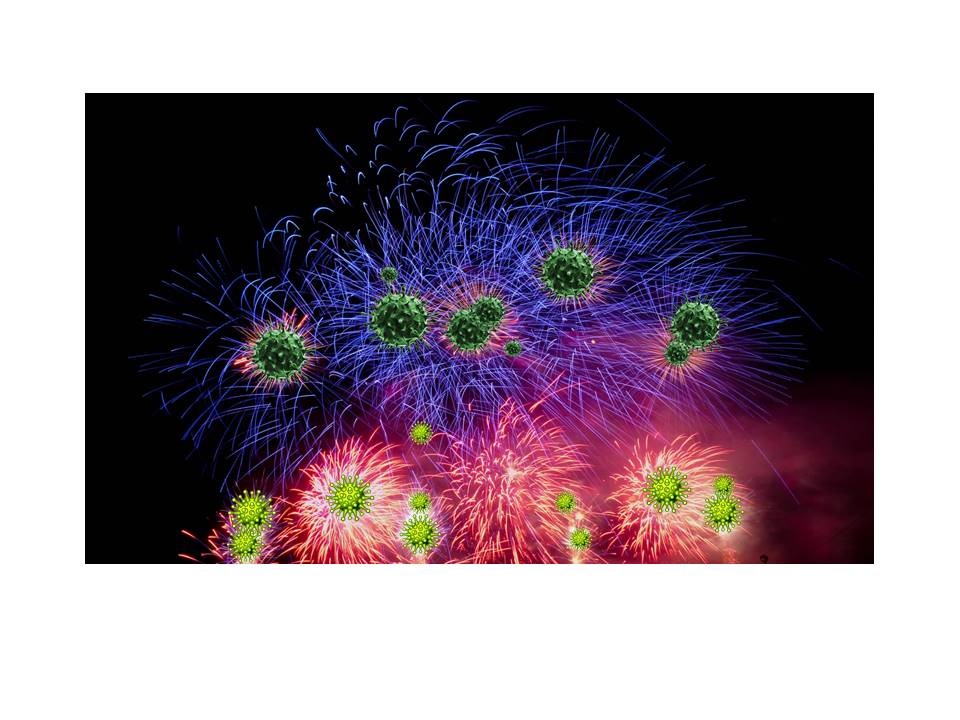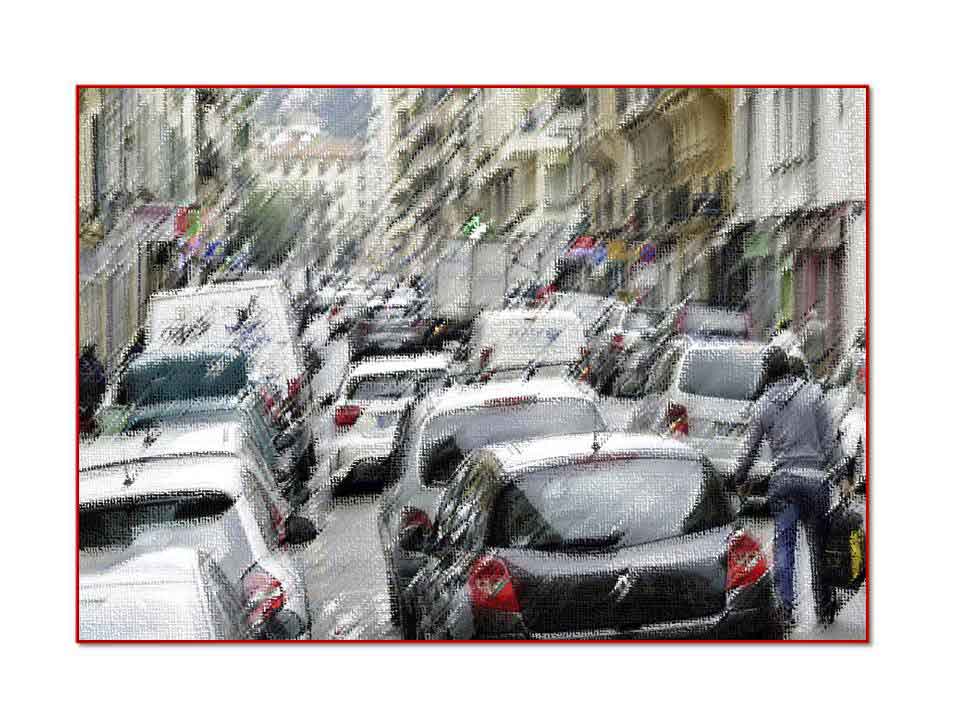Entendons-nous bien, dès le départ: j’ai même des ami.es philosophes, çà n’a rien à voir. Non, moi je parle ici des philosophes dont les médias sont friands. Et ce qui prend quelquefois un ton caustique n’en est pas moins argumenté, comme on va le lire.
La première chose qui me les rend insupportables, c’est cette posture massive de surplomb, au-dessus de la mêlée, dégagée des bassesses qui sont le quotidien du plus grand nombre, une posture qui pourrait se formuler pragmatiquement dans ce genre: «Vous êtes des idiots, empêtrés dans les contingences et les vicissitudes de vos petites vies. Moi, je sais prendre de la hauteur. J’aime à le dire avec un brio et si vous prenez cela pour de l’arrogance, tant pis pour vous!»
Pour le formuler encore en d’autres termes : cela s’apparente à du mépris.
La deuxième chose qui m’insupporte est qu’ils (ah oui, ce sont des hommes…) parlent en «je» et qu’ils invitent donc à penser en «je». Nous y sommes tellement habitué.es que cela ne nous choque plus, cela pourrait même nous flatter… Or, la société n’est pas, contrairement à leur implicite jamais interrogé, une constellation d’individus pensants. Pire: cet implicite est une option politique, celle qu’exprimait en son temps la Première Ministre de Grande-Bretagne, Margaret Thatcher : «There is no such thing as society», ce que l’on pourrait traduire par:
«Une société, ça n’existe pas, il n’y a que des individus».
Ce projet réductionniste restreint chaque personne à sa qualité de personne insulaire, à l’image des agrégats de consommateur/trices que considèrent les concepteurs de campagnes marketing, dans la suite des penseurs de l’idéal du marché. C’est enfin une focalisation sur le seul premier niveau de la grille d’Ardoino, qui en compte pourtant quatre ou cinq autres.
Troisièmement: leur approche est résolument conceptuelle, faisant un abondant usage de termes en «-isme» et en «-ité». Je ne nie pas l’intérêt et la légitimité de ces concepts, mais je pointe davantage un travers majeur, qui consiste à « substantifier » ce qui n’est avant tout qu’une idée. (1) On pourrait presque apparenter cela à du bovarysme, la beauté esthétique idéelle des concepts constituant un monde refuge, qui permet de se préserver des immanquables frustrations du monde réel. De plus, ces concepts sont le plus souvent élaborés dans une acception aristotélicienne, comme on va le voir, un trait critiquable et pourtant d’autant plus usité qu’on se situe dans la seule sphère de idées.
Quatrième argument: un usage massif d’un «nous», sensé rassembler tout le monde dans ses filets, indistinctement et sans le moindre questionnement sur l’usage de ce pronom. Ce trait est particulièrement critiquable, dans la mesure où il présuppose une communauté de situation, de réflexion, d’action et de responsabilité qui n’existe tout simplement pas dans la «triviale réalité». Ce «nous» présuppose l’évidence d’une unanimité qui est posée comme un axiome, alors que nos expériences de situations sociales fournissent autant d’occasions de percevoir l’inverse: conflits d’intérêts, différences socio-économiques, de visions du monde… tissent le quotidien des sociétés.
Deux approches philosophiques
On l’aura compris, je ne suis pas philosophe. Ce qui ne m’empêche pas de m’y être intéressé et de pouvoir modestement proposer une distinction entre deux conceptions contrastées, que les personnes davantage que moi documentées en histoire de la philosophie, seraient sans doute à même de commenter bien davantage.
Une première conception consiste à considérer que les «idées» sont premières et qu’elles conduisent ensuite à l’action qui en découle. En cohérence avec cette option, la tâche des penseurs consiste à construire des modèles de pensée, fournir des repères, des instruments pour juger. Le centre de gravité est ici la rigueur de la réflexion et la cohérence du modèle, d’autres ayant en charge de mener des actions cohérentes. Séparation nette, donc, entre la sphère de l’action et celle de la réflexion.
Une autre conception consiste à considérer que les acteurs socio-politiques agissent, selon les opportunités que présentent les situations qu’ils affrontent, mobilisant pour cela des représentations du monde et une visée de ce qui est désirable à leurs yeux, plus ou moins explicitement. Dans ce cas, la tâche des penseurs consiste à observer, écouter et élucider les fondements plus ou moins implicites de ces conduites et à en manifester les soubassements. L’action est ici la source d’inspiration du travail réflexif, les acteurs eux/elles-mêmes pouvant très bien s’y livrer. C’est très exactement ce que Gramsci, revisitant ce terme repris à Aristote, entendait par la «praxis».
On l’aura compris, je me sens davantage d’affinités avec la seconde option. Selon moi, les idées n’ont guère de pertinence en elles-mêmes, tant que des acteurs ne s’en sont pas saisis pour donner sens à la situation qu’ils vivent, apprécier la mesure dans laquelle elles leur conviennent ou non, identifier un horizon désirable et guider l’organisation de moyens concrets pour y arriver. Et dans le monde de l’action, de la contingence, les choses sont rarement aussi limpides que dans le monde des idées… On pourrait d’ailleurs le rappeler: dans l’antiquité grecque, des philosophes écrivaient bien peu : leur œuvre philosophique était leur vie elle-même, comme matière à leur propre réflexion autant qu’à celles de leurs contemporains.
Une relation de domination
La première approche, conceptuelle, consiste à clore sur lui-même le monde des idées, laissant à d’autres le soin de les incarner. Dans cette conception, les mondes de la pensée et de l’action sont des mondes distincts, si pas étanches, mais qui relèvent en tout cas de logiques internes, de pertinences et de systèmes de légitimation bien distincts. Mais il y a plus: la structure de la relation entre pensée et action est conçue ici comme une structure de domination. Et elle fait écho à d’autres structures de dominations comme celles de l’esprit sur le corps, de l’être humain sur la nature, de l’intellectuel sur le manuel, de celui qui a des biens et des loisirs sur celui qui doit travailler pour subvenir à ses besoins, voire de l’«homme» sur la «femme»…
De bons clients des médias.
Finalement, que des personnes raisonnent dans les termes que j’ai démontés plus haut, après tout, pourquoi pas, c’est leur droit. Le plus exaspérant dans tout cela, c’est la place que ce discours philosophique prend dans les médias, envahissant tous les lieux d’expression et s’installant comme seule parole légitime, dès qu’il s’agit de commenter des faits de société. Où sont les sociologues, les anthropologues, les politologues, les psychosociologues? C’est alors ce qu’il s’agit de comprendre.
Pour avoir déjà examiné une question analogue à propos d’un autre objet (il s’agissait, en l’occurrence, la manière dont les médias rendent compte des conflits sociaux), je propose une première exploration de cette question : quels sont les éléments internes au système médiatique qui peuvent expliquer cet état de fait ? Ainsi, on peut interroger la formation des journalistes et des animateur/trices et s’inquiéter de savoir quelles sont les sciences sociales qu’ils/elles ont été rencontré.es dans leur parcours. On sait par exemple la tendance des professionnel.les des médias à faire appel, dans l’urgence que leur imposent leurs conditions de travail, à des personnes croisées dans leur parcours de formation.
On peut aussi s’intéresser à ce qui préside à la conception des grilles de programmes. Dans un contexte concurrentiel, c’est notamment la comparaison qui est faite avec les autres opérateurs qui guide ces choix, qu’il s’agisse d’imiter ou de se distinguer. Plus: le suivi quasi immédiat des taux d’audience peut conduire à inviter dans un studio un invité qui a «cartonné» peu avant chez un concurrent. Il s’agit donc d’une gamme d’explications qui ressortissent des règles du jeu interne au système des médias. Ne négligeons pas non plus l’efficacité des «services de Com.» des éditeurs, qui sont en situation de fournir aux médias des auteurs «qui passent» bien…
L’omniprésence de l’individu
On est sans doute loin d’avoir fait le tour de la question, quant aux règles du jeu qui prévalent au sein du champ médiatique. On en restera là, à ce stade, pour agrandir ensuite bien plus largement la focale et s’interroger sur ce qui peut bien expliquer cette omniprésence du discours philosophique. J’y vois pour ma part une résonnance avec la «société des individus», pour reprendre le titre de l’ouvrage classique du sociologue Norbert Elias. En Occident tout au moins, la croyance contemporaine selon laquelle la société est composée d’individus est en fait le résultat d’un processus étalé sur plusieurs siècles et qui débouche sur un paradoxe : à l’instant même où une personne se conçoit comme un individu, elle s’actualise comme le pur produit de cette évolution, dont elle est ainsi le témoignage autant que le relais. Dans le même mouvement, elle affirme son autonomie à l’égard des contraintes sociales, en même temps qu’elle manifeste aussi le point où elle s’y conforme. (2)
Cette centration sur l’individu pensant est loin d’être une exclusivité de la philosophie. Le scénario qui prévaut dans l’économie orthodoxe d’un consommateur rationnel qui collecte complètement une information disponible sur le marché et prend sur cette base des décisions qui visent à maximiser ses intérêts, contribuant ainsi à l’équilibre optimal dudit marché, sans la moindre régulation extérieure que la «main invisible» du marché, apparaît comme une fiction aussitôt que l’on observe les comportements économiques avec d’autres yeux que ceux des économistes.
On retrouve également cette même centration sur l’individu pensant, dans le champ des sciences de l’éducation. Ainsi, l’usage du si crispant vocable d’ «apprenant», dont l’implicite est celui d’un individu isolé, détaché des relations sociales dont il est issu, en même temps qu’il y prend place. Cette conception occulte la vision d’une personne socialement, culturellement, sociologiquement… située, dont les capacités de réflexion sont issues de son histoire sociale et de ses attachements/détachements, de ses aspirations et de ses renoncements…
Les succès scientifiques et éditoriaux des sciences cognitives participent sans doute du même mouvement. C’est l’objet d’un récent ouvrage d’Alain Ehrenberg qu’il consacre, non aux sciences cognitives et aux neurosciences, mais plus précisément aux conditions sociétales de leur succès, ou de leur «réception» (3) Il souligne notamment que L’individu idéalisé par l’approche cognitive est donc aussi celui qui est privilégié dans les modes d’organisation du travail autant que dans la conditionnalité des aides sociales. L’idéal social majeur aujourd’hui met au centre la valeur d’autonomie comme valeur pivot qui organise nos attentes à l’égard d’une vie bonne et l’actualisation de nos potentialités. De plus, l’image sous-jacente qui est massivement à l’œuvre est la métaphore l’ordinateur. Une question qi guide encore nombre de recherches et celle-ci: quelles sont les compétences à maîtriser par une machine, de manière à ce qu’elle soit capable de dialoguer avec une autre? On occulte ainsi le fait que, dans le cas de sujets humains, ces compétences sont aussi des habilités construites, tant dans son histoire personnelle, en relation avec d’autres sujets humains (ontogénèse) et ses environnements non-humains, mais également issus d’une sélection au fil de l’évolution de l’espère humaine (phylogénèse). Autre oublié, et non des moindres : le corps. On se réfèrera ici tout particulièrement à l’œuvre de Francisco Varela. (4)
Dans le champ politique, l’usage récurrent du terme de «citoyen.ne» participe de ce même mouvement de pensée. Le/la citoyen.ne est généralement paré de toutes les vertus, réflexivité, réactivité immédiate (Ah cette insupportable mode des micros-trottoirs!) mais surtout abordé comme un être isolé, capable de formuler seul et instantanément un avis péremptoire, sans avoir besoin pour cela d’échanger avec d’autres, d’enrichir sa propre réflexion au contact d’autres points de vue… On retrouve ici la deuxième critique adressée plus haut à l’expression majoritaire des philosophes médiatiquement exposé: Cet individu serait sans affiliation, il n’appartiendrait à aucune organisation, aucun groupe, aucun cercle… en d’autres termes, pour le prendre le vocabulaire de Pierre Rosanvallon, il serait «désaffilié».
Le contrepoids à ces conceptions est à chercher dans la l’épistémologie de la complexité, notamment avec la notion d’émergence. Cette notion désigne le fait qu’un ensemble quelconque présente des propriétés qui ne sont déductibles à partir de l’examen des propriétés des éléments distincts qui le composent. Et s’il en est ainsi, c’est notamment parce que ces éléments ne sont pas regroupés aléatoirement dans cet ensemble comme des billes de verre dans un sac, mais sont disposés les uns par rapport aux autres selon une organisation spécifique. Le biologiste Albert Jacquard prend cet exemple. L’oxygène (O) et l’hydrogène (H) sont chacun des gaz inflammables. Ils peuvent même être des accélérateurs de feu. Pourtant, une certaine combinaison de ces deux composants (H2O) permet par contre d’éteindre ce même feu. On voit bien que cette propriété de l’eau n’est pas déductible à partir de l’examen des propriétés de ses composants.
Ce qui est valable pour un exemple aussi simple que de l’eau l’est a fortiori pour une forêt, voire même un bosquet, qui ne peuvent se résoudre à la simple juxtaposition d’arbres. Les distances entre les «individus», le nourrissage des adultes par les petits via les réseaux de racines et de mycéliums, les étages de végétation, le couvert végétal et la génération d’humus, la régulation de l’humidité,… fait de cet ensemble un biotope pour de très nombreuses espèces animales et végétales, et dont les propriétés ne se résument pas à la simple coprésence d’un certain nombre d’arbres. Et ce biotope, dans sa complexité, constitue en tant que tel un objet d’étude légitime, distinct d’une étude portant tout aussi légitimement sur un arbre en particulier. Les travaux d’Esnst Zücher sont tout à fait exemplaires de ce propos. (5)
Et qu’on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas! Je ne suis pas occupé à faire ici de l’anthropomorphisme. J’affirme plutôt que la légitimité qui est reconnue aux biologistes (l’étude d’une forêt ne se rabat pas sur le seul niveau de l’étude des caractéristiques d’un arbre) doit également être accordée aux sciences sociales qui se donnent pour objets d’études des ensembles plus vastes que les individus humains abordés dans leur individualité.
Où sont les sociologues?
Où sont les sociologues, les anthropologues, les politologues, les psychosociologues ? Ils et elles semblent effacé.es de l’espace public, précisément en raison du fait que ces disciplines, par la nature de leurs objets d’études, constituent autant de rappels des contraintes qui s’imposent aux individus et que les individus modernes ne veulent plus «conce-voir».
Si les sciences sociales sont désormais quasi absentes des médias, elles semblent aussi avoir disparu des cercles où s’élaborent les décisions politiques. C’était notamment ce même constat qui avait motivé, en 2002, l’ouvrage dirigé par Bernard Lahire, au titre quelque peu provocateur, «A quoi sert la sociologie?». Traductions opérationnelles de cette désaffection: diminutions des financements pour des recherches menées dans ces disciplines, si souvent mises en situation de devoir justifier leur légitimité. Et lorsque les pouvoirs publics cherchent à éclairer une situation qui demande des décisions, c’est à d’autres scientifiques que celles et ceux issus des sciences sociales auxquel.les ils font appel.
La bataille est donc loin d’être gagnée. Mais il peut aussi revenir aux sciences sociales de s’interroger sur ce qui a conduit à cette situation. (6) Sans prétendre faire ainsi le tour de la question, je propose ici quelques pistes, sous la forme d’une paresseuse et désordonnée «bullet points list»…
• Veiller à ce que les services «relations publiques» des institutions qui emploient des chercheur/ses en sociologie soient bien informés des sujets de leurs travaux et sur lesquels ils et elles pourraient intervenir avec pertinence dans les débats médiatiques;
• S’enquérir proactivement auprès des autorités publiques des questions pour lesquelles des recherches menées en sociologie pourraient éclairer des domaines dans lesquels des décisions sont à prendre;
• Tout aussi proactivement, prendre contact avec différents médias et faire offre de contributions sur les «sujets de société». On l’a vu, les médias étant très sensibles à ce que font leurs concurrents, une porte ouverte auprès de l’un d’eux est potentiellement des portes ouvertes chez d’autres;
• Repérage volontariste des journalistes, présentateur/trices, animateur/trices, responsables de rubriques,… dont le travail laisse voir la réceptivité aux éclairages des sciences sociales;
• Etudier, avec les outils propres aux sciences sociales, les raisons de l’estompement de la sociologie dans les lieux de débats et de décisions et proposer sur cette base des manières pragmatiques et cohérentes de changer cet état de choses. Un point particulier est celui de la place controversée des expert.es;
• Les médias sont attentifs aux réactions de leur audience. Réagir sur les espaces d’expression qu’ils organisent (commentaires sur leurs sites, messages sur leurs réseaux sociaux et autres «courriers de lecteurs») peut avoir son utilité, pour peu que la critique soit constructive et, mieux, suggère d’autres regards sur l’actualité et des personnes crédibles pour en parler;
• La sociologie n’en a sans doute pas fini avec la nécessité de défendre la spécificité de son objet et à poursuivre ses efforts d’émancipation à l’égard de la philosophie. (7) Réinterroger ses fondements, ses concepts, ses méthodes, ce qu’elle sans doute déjà fait plus que toute autre discipline, peut toujours être fécond; (8)
• …
Alors, on conclut ?
Cet article avait commencé comme un billet d’humeur, motivé par l’agaçante omniprésence de la philosophie comme paradigme d’approche des phénomènes de société. Et puis, les choses ont pris davantage d’ampleur. Au fil de l’écriture, on a évoqué la posture de la philosophie (surplomb, détachement des contingences de l’action…), l’air du temps, la société des individus, les règles du jeu interne à l’univers des médias,… Qu’en conclure, alors qu’on a déjà dépassé depuis longtemps le « TLNR? (9)
Dans son imperfection même, cet article prend les apparences d’un nœud que l’on fait dans un mouchoir pour ne pas oublier quelque chose, en l’occurrence, de poursuivre la réflexion. Comment susciter la vigilance, face à tout discours orienté vers un horizon d’indépendance impossible à attendre et qui fait peser sur les individus atomisés un poids exorbitant? Comment ne pas concevoir les relations sociales comme des contraintes dont il faut s’émanciper mais au contraire comme des conditions préalables à nos existences d’êtres sociaux? Comment fournir au plus grand nombre des occasions d’expérimenter cette dialectique de l’un et du multiple, du même et du différent, des inextricables rapports de co-dépendance qui tissent les sociétés?
Cette imperfection est un peu comme une prise de rendez-vous, une invitation à poursuivre, la réflexion sans doute, mais surtout un appel à l’action, organisée avec d’autres, un appel à faire de la politique, finalement !
__________________________________________
(1) Gregory Bateson a travaillé ce point. On lira notamment son chapitre «La double contrainte, 1969» dans le second tome de son ouvrage: «Vers une écologie de l’esprit» Seuil, 1980. Pages 42-49.
(2) J’ai eu l’occasion de développer ailleurs ce raisonnement. Voir: «Distinguer sans séparer, relier sans confondre».
(3) ERHENBERG Alain, (2018), «La mécanique des passions: cerveau, comportement, société», Odile Jacob, Paris.
(4) Francisco J. VARELA, (1989-1996), «Invitation aux sciences cognitives», Seuil, Points, Science.
Francisco J. VARELA, Evan THOMPSON, Eleanor Rosch, (1993) «L’Inscription corporelle de l’esprit, Sciences cognitives et expérience humaine», Seuil, la Couleur des Idées.
(5) ZUCHER Ernst, « Les arbres entre visible et invisible », Actes Sud, 2016.
(6) On peut estimer que si l’on est engagé dans une relation qui nous insatisfait, on a intérêt, non à blâmer l’autre (ce qui est sans doute commode, mais ce qui revient aussi à lui laisser les clés du changement espéré), mais au contraire à rechercher quels comportements de notre part contribuent au maintien de cette relation frustrante. Après tout, n’est-ce pas sur nous-mêmes que nous avons la capacité d’action la plus aisée. Dès lors, dans cette approche interactionnelle, changer ces comportements de notre part revient aussi à modifier les modalités de cette relation.
(7) Voir: Tarragoni F. (2016). « L’émancipation de la pensée sociologique: point de vue aveugle? » Revue Mauss, 2016/2, n°48, pages 117-134.
(8) Pensons à cette ouvrage provocateur de Bruno LATOUR: «Changer de société, refaire de la sociologie», avec sa proposition de la «sociologie de l’acteur-réseau», invitant à revisiter la notion même de société et à inclure résolument les non humains dans la réflexion. La Découverte/Poche, 2007.
(9) Too Long No Read, («Trop long, je ne lis pas») est l’acronyme d’un projet d’intelligence artificielle sur lequel travaille Facebook et qui consiste à résumer automatiquement des articles de presse jugés trop longs en les transformant listes de «bullet points».